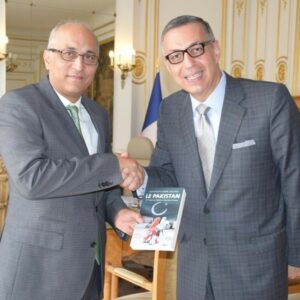Chacun avance ses pions dans l’attente de la nouvelle politique étrangère américaine.
Un peu plus d’un mois après la chute du régime d’Assad et la prise du pouvoir par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Cham, où en est la Syrie ? À qui profite ce basculement géopolitique ? Quelle sera la politique américaine au lendemain de l’investiture de Donald Trump ?
Al-Joulani lisse son image
Depuis sa prise du pouvoir, Abou Mohammed Al-Joulani, ancienne figure cardinale des mouvances djihadistes, a su manœuvrer pour asseoir son pouvoir sur la Syrie. Le nouveau maître de Damas, qui a troqué son patronyme de guerre Al-Joulani pour son nom d’état civil Ahmed al-Chareh et tondu sa barbe, ne cesse de donner des gages de tolérance aux minorités alaouites, chrétiennes et kurdes.
Il œuvre en faveur de l’unification et s’efforce de dissoudre les groupes armés au sein d’une force nationale. L’objectif est limpide : gagner du temps pour à la fois rassurer sa population qui conserve les traumatismes de l’État islamique, et lisser son image auprès des puissances internationales dans le but que les sanctions contre la Syrie soient rapidement levées.
“La communauté internationale veut y croire, comme le prouve la multiplication des rencontres diplomatiques pour participer à la reconstruction complexe et incertaine de la Syrie”
La communauté internationale veut y croire, comme le prouve la multiplication des rencontres diplomatiques pour participer à la reconstruction complexe et incertaine de la Syrie. Alors que les chancelleries française et allemande se sont rendues à Damas pour s’entretenir avec Al-Joulani, l’Arabie saoudite a organisé ce dimanche 12 janvier un sommet sur le futur de la Syrie avec les pays arabes et occidentaux. Les États-Unis, quant à eux, ont annoncé renoncer à offrir une récompense pour l’arrestation d’Al-Joulani.
Israël, Turquie et pays du Golfe, les grands gagnants
Chacun avance ses pions dans l’attente de la nouvelle politique étrangère américaine. Israël, la Turquie et les pays du golfe Persique sont pour l’instant les grands gagnants de ce basculement géopolitique.
La chute du régime d’Assad, allié historique de l’Iran par lequel s’approvisionnait le Hezbollah libanais, sert largement les intérêts d’Israël. En bombardant les infrastructures militaires et les stocks d’armement syriens, Tel-Aviv a voulu anéantir le potentiel militaire du pays et éviter qu’il ne tombe entre les mains de factions djihadistes encore présentes dans certaines régions du pays.
“Alors que le Qatar a annoncé dès décembre la réouverture de son ambassade, l’Arabie saoudite a appelé à la levée des sanctions lors du sommet de ce dimanche.”
Les pays du golfe Persique et l’islam sunnite sont au cœur de l’impulsion diplomatique depuis la chute du régime d’Assad et prennent une forme de revanche sur l’influence iranienne historique. Alors que le Qatar a annoncé dès décembre la réouverture de son ambassade, l’Arabie saoudite a appelé à la levée des sanctions lors du sommet de ce dimanche. Mais cette projection ne se limite pas à la Syrie. Détail qui ne trompe pas, le nouveau président du Liban, Joseph Aoun, qui a pris soin de ménager le Hezbollah pour sa désignation, a réservé sa première visite à l’étranger à l’Arabie saoudite.
La Turquie de son côté, même si elle nie son implication dans le renversement du régime syrien, profite largement de la chute d’Assad pour poursuivre son offensive contre les Kurdes du YPG (Unité de protection du peuple) au nord-est du pays, branche syrienne du PKK qu’Ankara considère comme terroriste.
Le repli tactique des Russes
Pourtant, l’avenir de la Syrie reste profondément instable avec une incertitude sur le maintien de la présence russe et sur la future politique américaine.
Alors qu’ils sont présents depuis plus de 10 ans et ont combattu l’État islamiste et d’autres factions djihadistes, les Russes ont refusé d’engager leurs forces contre le groupe HTS et se sont repliés sur leurs bases de Tartous et Hmeimim. Situées au nord-ouest du pays, ces dernières sont hautement stratégiques puisqu’elles offrent à la Russie une projection navale et aérienne directe sur le bassin méditerranéen, l’Europe et l’Afrique. Comment expliquer ce repli tactique ? Vladimir Poutine a-t-il obtenu des garanties d’Erdogan et d’Al-Joulani ?
La grande inconnue américaine
Mais la grande et vraie inconnue est celle de la politique américaine. HTS a-t-il juste profité de la période de transition entre Biden et Trump pour mener son offensive, ou y a-t-il eu un feu vert explicite de Washington aux rebelles islamistes ?
Quoi qu’il en soit, la nouvelle administration américaine devra trancher de nombreuses questions épineuses :
– Quel avenir pour les Kurdes au nord de la Syrie compte tenu de la pression de la Turquie qui ne veut pas entendre parler d’un État sur son flanc sud ?
“Les États-Unis se laveront-ils les mains de la Syrie comme ils l’ont fait de l’Afghanistan ?”
– Quelle tolérance pour les bases russes alors même que Donald Trump a annoncé préparer une rencontre avec Poutine pour trouver une issue au conflit en Ukraine, initiative dont s’est félicité Moscou ? Les Russes parviendront-ils à négocier le maintien des bases dans le cadre d’un grand marchandage avec les États-Unis sur l’Ukraine et l’avenir du programme nucléaire iranien ?
– Quelle sera la politique américaine à l’égard des autorités islamistes ? Alors que Mazloum Abdi, le représentant des Forces démocratiques syriennes (FDS), affirme être tombé d’accord avec les autorités actuelles sur l’importance de l’intégrité et de l’unité du pays, d’autres voix doutent sérieusement de la sincérité de ces promesses et de la capacité des autorités actuelles à contrôler l’ensemble du territoire. Cela sans que des factions encore plus radicales, comme l’État islamique, ne profitent du chaos.
Les États-Unis se laveront-ils les mains de la Syrie comme ils l’ont fait de l’Afghanistan, ou au contraire veilleront-ils avec les différents États de la région à garantir les droits des minorités ?
Enfin, l’enjeu sera aussi économique tant la détresse de la population civile et les besoins de reconstruction sont colossaux.
Par Ardavan Amir-Aslani et Sixtine Dupont
Paru dans Le Nouvel Economiste du 14 janvier 2025.